La police du roulage et des messageries publiques ancêtre du code de la route a mis en place les conditions techniques imposées aux véhicules et le respect du partage des voies de circulation.
La circulation routière devient de plus en plus importante et il faut l’organiser, tant sur la mécanique que sur la circulation en elle-même. Naturellement, dans les premières lois, les voitures dont il est question sont des charrettes, carrosses ou diligences. Il n’est là pas encore question de voiture à moteur.
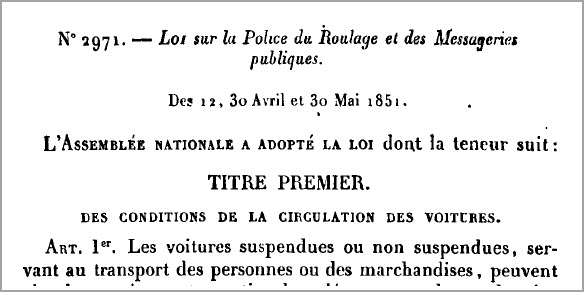
L’article 1er de la loi du 30 mai 1851 précise que « les voitures suspendues ou non suspendues, servant au transport des personnes ou des marchandises, peuvent circuler sur les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication sans aucune condition de réglementation de poids ou de largeur de jantes ».
L’article 2 détermine la forme des moyeux, le maximum de la longueur des essieux, la forme des bandes de roues, les clous des bandes et les conditions à observer pour l’emplacement et les dimensions de la plaque rendue obligatoire par l’article 3. Le Titre II de cette loi rappelle toutes les pénalités et autres contraventions appliquées pour tout manquement à ladite loi.
Cette loi du 30 mai 1851 annule toutes les précédentes : 19 mai 1802, 27 février 1804 et le décret du 23 juin 1806.
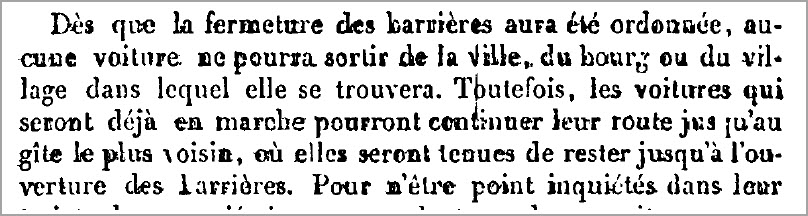
La circulation des véhicules prend de l’ampleur et le décret du 10 août 1852 apporte d’autres obligations. La dimension des essieux est limitée à 2,50 mètres de longueur, le nombre de chevaux attelés est fixé en fonction du nombre de roues du véhicules.
Instauration, par l’article 6, des barrières de dégel : « Le ministre des travaux publics détermine les départements dans lesquels il pourra être établis, sur les routes nationales et départementales, des barrières pour restreindre la circulation pendant les temps de dégel. » Les mêmes mesures seront appliquées sur les chemins de grande communication par les préfets.
L’article 15 rappelle « qu’aucune voiture marchant isolément ou en tête d’un convoi ne pourra circuler pendant la nuit sans être pourvue d’un fallot ou d’une lanterne allumée« .
L’article 4 du décret du 24 février 1858 indique que « les préfets pour appliquer, par des arrêtés spéciaux, aux voitures particulières servant au transport des personnes, les dispositions du 1er paragraphe de l’article 15 du décret du 10 août 1852, relatif à l’éclairage ».
Le décret du 10 mars 1899 règlemente l’usage des véhicules à moteur ! Elle reprend les bases des précédentes lois sur la police du roulage : la sécurité contre les incendies, le groupement des organes de manœuvre, deux systèmes de freinage … Le second paragraphe de l’article 5 impose aux véhicules de plus de 250 kg d’être munis d’un dispositif permettant d’effectuer la marche arrière. La voiture est contrôlée par le service des Mines qui, après constatation que la voiture présentée aura satisfait aux prescriptions réglementaires, dressera un procès-verbal en deux exemplaires dont un sera remis au propriétaire ou au conducteur. Outre ces obligations, cet article 7 impose aussi que chaque voiture indique en apparence « le nom du constructeur, l’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type« .
Conformément à l’article 8, le propriétaire du véhicule, avant de le mettre en circulation, dit adresser au préfet de son département, une déclaration accompagnée de la copie du certificat des Mines.
Le plus important de cette loi est la création d’un certificat de capacité pour les conducteurs, en d’autres termes, le permis de conduire. « Nul ne pourra conduire une automobile s’il n’est porteur d’un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence sur l’avis favorable du service des Mines« .
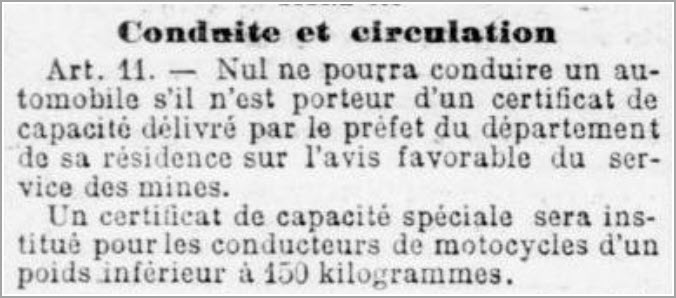
C’est l’article 3 du décret du 10 septembre 1901 qui instaure la plaque d’immatriculation « Si l’automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à trente kilomètres à l’heure, il sera pourvu de deux plaques d’identité, portant un numéro d’ordre, qui devront toujours être placées en évidence à l’avant et à l’arrière du véhicule. Le ministre des travaux publiques fixera le modèle de ces plaques, le mode de pose et leur mode d’éclairage pendant la nuit. Il fixera également le mode d’attribution aux intéressés des numéros d’ordre. »
Le 11 septembre 1901, le ministre des Travaux publics arrête précise les conditions de déclaration, d’enregistrement et d’application des plaques d’immatriculation attribuées au automobiles pouvant rouler à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l’heure.
« Ce numéro d’ordre sera formé d’un groupe de chiffres arabes suivi de lettres majuscules romaines caractéristiques du service de l’ingénieur en chef […]. Le groupe de chiffres sera séparé des lettres par un trait horizontal placé à moitié hauteur de la plaque […]«
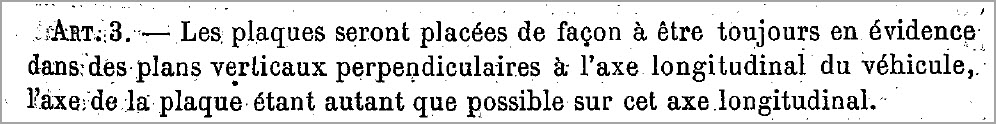
Les années suivantes amèneront des modifications administratives importantes concernant le code de la route, le permis de conduire ainsi que les indications portées sur les plaques d'immatriculation pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui…
Sources :
- Gallica/BnF
- Bulletin des Lois – 1er semestre 1851 – n° 398
- Bulletin des Lois – 2ème semestre 1852 – n° 573
- Bulletin des Lois – 1er semestre 1858 – n° 583
- Recueil des lois, ordonnances et décrets, règlements et circulaires du Ministère des Tavaux publics – années 1900 et 1901
- Journal des Sports – 11 mars 1899 – n° 1905
























